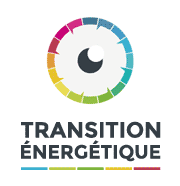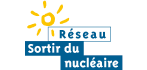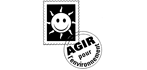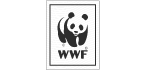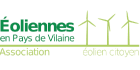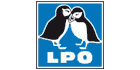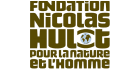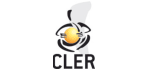D’ici à 2017, 80% du parc nucléaire français aura atteint 30 années de fonctionnement, durée de vie initialement envisagée pour le parc nucléaire. 23 réacteurs ont déjà dépassé trente ans de fonctionnement. L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire lui-même alerte sur le risque de rupture brutale de la cuve d’une dizaine de réacteurs en France passé 35 ans. EDF souhaite prolonger la durée de fonctionnement de ses réacteurs au-delà de 40 ans, sans être capable de chiffrer précisément les coûts de cette prolongation. Entre 2008 et janvier 2011, l’évaluation de ces coûts par EDF a été multipliée par 2, passant de 400 millions à 900 millions d’euros par réacteur, ces chiffres ne prenant pas en compte les travaux post-Fukushima exigés par l’ASN. Quant au réacteur EPR, le chantier a déjà pris 4 années de retard, entrainant un surcoût évalué pour l’instant à 5,2 milliards d’euros, surcoût qui sera assumé en bonne partie par le contribuable français. Pour baisser à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique, comme s’y est engagé François Hollande, seule la fermeture de Fessenheim est pour l’instant programmée. L’équation ne tient pas. Il est impossible de réduire de 25 points la part du nucléaire en fermant une centrale et en ouvrant un EPR. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de fermer une trentaine de réacteurs d’ici à 2025 - sachant que, pour les ONG et associations, l'objectif doit rester l'arrêt du nucléaire.
Mesure phare :
- Adoption d'une décision de sortie du nucléaire, accompagnée d'un calendrier comportant des
échéances concrètes de fermetures de réacteurs.
- Parmi ces actes concrets, la fermeture dès maintenant des centrales les plus dangereuses.
- L’interdiction de construire de nouveaux réacteurs (dont l’ATMEA), incluant l’arrêt du chantier du réacteur EPR de Flamanville.
Autres mesures :
- Arrêt des investissements dans le développement de la 4e génération.
- Arrêt des exportations de technologie nucléaire à l'étranger.
- Arrêt du retraitement des déchets, ainsi que de la production de MOX, dangereux combustible à base de plutonium.
- Arrêt des projets d’enfouissement de déchets nucléaires.
L’Allemagne sort du nucléaire sans retourner à la bougie ni polluer davantage
En 2000, l’Allemagne s’est engagée dans la voie de la sortie du nucléaire ; en parallèle, elle a
mis en place une politique de soutien aux énergies renouvelables. En 2011, la catastrophe de Fukushima a conduit l’Allemagne à relancer cette politique de sortie. Sur les 17 réacteurs que comptait le pays, 8 ont été arrêtés immédiatement et les autres doivent être fermés progressivement d’ici à 2022. Les salariés concernés ont été reclassés sans problème particulier.
Grâce à sa politique de maîtrise de l’énergie, mais surtout au développement soutenu des
énergies renouvelables, l’Allemagne fait face à cette réduction de la production sans recourir
davantage aux énergies fossiles, en respectant ses objectifs de réduction d’émissions de CO2
et en restant exportatrice nette d’électricité[1].
[1] http://www.iddri.org/Publications/L-impact-de-la-decision-post-Fukushima-sur-le-tournant-energetique-allemand